-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
...J'arrive donc à Niort qui se trouve à 12 km de Frontenay et là je fus en passsant voir mon oncle, le seul qui me restait du côté de ma mère...
Représentation schématique du cheminement emprunté par Jean Baptiste
Voyage en Touraine – Départ d’Epannes
Séjour à Tours – Diverses rencontres
Départ pour Angers et Nantes
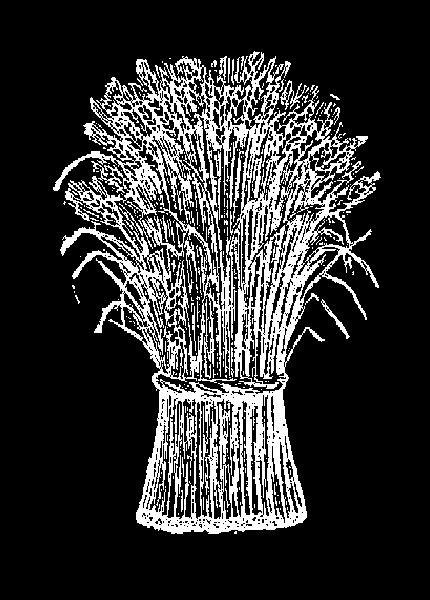
En cliquant sur les documents, vous obtiendrez une image agrandie

Niort (Deux-Sèvres) - La Gare, Carte postale vers 1900
Le 5 août 1856, je pars d’Epannes après avoir dit adieu à mes principaux amis. Lorsque je fus à Frontenay qui se trouve à 5 km d’Epannes, là je commence à chanter comme un vrai voyageur mais il me restait à croire qu’il n’était pas de même de ma sœur et de ma mère. J’étais donc décidé de me rendre à Tours sans m’arrêter car les journaux racontaient chaque jour le désastre causé par l’inondation et je voulais m’assurer de moi-même si tout cela pouvait être vrai.
J’arrive donc à Niort qui se trouve à 12 km de Frontenay et là je fus en passant voir mon oncle, le seul qui me restait du côté de ma mère (*). Il me reçut assez bien, il voulut me demander le sujet de mon départ mais je ne voulus pas rentrer dans le long détail au sujet de cette affaire car je voulais aller coucher à Saint-Maixent qui se trouve à 36 km de Niort. Il m’offrit de prendre quelques nourritures, j’acceptais mais presque debout et je lui dis au revoir et je fus au bureau de police pour faire viser mon livret. On ne voulut pas me viser, disant qu’il n’était pas visé à Niort, qu’ils ne pouvaient pas se permettre de viser. « Et bien je leur dis, je partirai quand même…». Je leur tourne le dos et je prends la route de Paris.
(*) Louis GELIN, jardinier à Niort
Page 20
 ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________Lorsque je fus à quelques distances de Niort, je m’arrête pour sécher une chemise que je n’avais pas donné le temps de sécher avant que de partir d’Epannes. Pendant que mon linge séchait, moi je prends quelque lecture dans ma géographie. J’étais occupé à cette besogne quand un jeune homme vient m’interrompre en m’adressant la parole. Ce jeune homme était âgé d’à peu près quatorze ans et il était boulanger de sa profession. Il voyageait comme moi, à peine avait-il la force de porter son baluchon.
Compagnons-boulangers - Image parue dans 'L'Illustration" à la fin du XIXème siècle
Je voyais une auberge à quelques pas de là, nous fûmes prendre un verre de vin. Dans cette auberge, il se trouve un marchand chiffonnier que je connaissais particulièrement et de son côté il connaissait l’estime de ma sœur envers moi. Le malheureux tomba de son nuage de me voir chargé d’un baluchon, la gourde au côté, un vrai rouleur… Il fut un instant sans rien me dire et puis il parla ainsi d’une voix émue Vous voila mon cher Gerbier, mais vous partez donc pour un long voyage car vous avez le costume d’un voyageur ?... Moi je suis parti mais je ne sais quand je reviendrai, mais c’est tout probable que mon voyage sera long d’après mes désirs… Est-ce que vous abandonnez votre pays pour longtemps ?... Moi je n’en sais rien, mais c’est plus que sûr car j’ai fais mes adieux en partant… Oh !... Je ne puis le croire et que deviendra votre sœur qui vous aimait si tendrement, elle va mourir d’ennui ?... Non, non mon cher, ma sœur a été avertie par moi de mon départ et de plus je me suis procuré un remplaçant qui est mon frère… Allons, le tour arrive, je vous dis adieu…Non, je vais faire un petit bout de route avec vous car je vais à La Crêche pour des affaires de mon commerce… Très volontiers mon cher, partons !... ». Je dis au revoir au jeune boulanger et puis nous partons ensemble. La route fut faite assez prestement. Nous arrivons à La Crèche et là nous buvons un verre de bière ensemble et moi je continue ma route jusqu’à Saint-Maixent.
Le soleil n’était pas encore couché, je me voyais tout le temps de gagner l’endroit voisin. Je ne fis donc que de donner un coup d’œil dans cette petite ville où j’aperçus une magnifique promenade plantée de tilleuls et taillés avec principe. Comme j’admirais cela, une dame crie après moi. Du premier abord je ne fis pas attention, mais les cris se répétaient. Je tourne la tête et je vois une femme qui m’adresse la parole en disant « Monsieur si vous voulez venir loger chez moi vous serez très bien… C’est possible Madame mais je ne couche pas ici, je veux gagner le village voisin. Et bien allez à la Croix-Blanche chez ma sœur, vous n’en serez pas fâché… Oui Madame, je vous promets d’y aller de votre part… ».
Je gagne donc le village. Je suis arrivé, il faisait nuit. Je m’adresse à l’auberge indiquée. On me reçut très bien. Une conversation suivit mon arrivée et comme j’étais appuyé le coude sur la table, trois hommes rentrent qui se mirent à boire la goutte, parmi lesquels se trouvait le maire de l’endroit. Celui-ci m’engageât à prendre la goutte avec eux. Moi je remercie d’abord mais par un signe de l’hôtesse je compris qu’il était prudent d’accepter. En effet, une goutte à demi-verre me fut versée et là le maire se fit connaître en disant qu’il estimait les voyageurs et puis il me salue d’un bonsoir.
L’heure du dîner arrive, je me trouve avec des fendeurs bas-normands. Une conversation sur le voyage fut suivie jusqu’à sommeil…
Le lendemain, je pris une goutte et je me dirige vers Poitiers qui se trouve à 40 km de Saint-Maixent. Je fus déjeuner à Lusignan, charmant petit endroit où il y a un coteau à la gauche sur lequel se trouvent de superbes promenades d’où l’on découvre de riants points de vue. Après ce large déjeuner je me dirige vers Poitiers. Cette petite distance ne donne aucune chose de remarque et ne laisse apercevoir que des bocages et des terrains stériles, en un mot rien de remarquable. J’étais à deux lieues de Poitiers, la soif se fit sentir. N’ayant rien dans ma gourde, je rentre dans une auberge appelée « A la tour de Malakoff » où je mange deux œufs durs et je bois une chopine de vin blanc. De là, je gagne Poitiers et comme je monte la côte pour gagner le faubourg, je fus auprès de deux ouvriers, mais leur physique ne me plut pas, la conversation fut courte.
Page 21
 ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________J’arrive donc à Poitiers. Ne connaissant pas cette ville, je suivis la rue dans laquelle j’étais entré. Cette rue me conduisit sur une belle place et comme j’avais envie de prendre le chemin de fer pour me rendre à Tours, je m’informe à des employés s’il n’y avait pas un train qui partait le soir, ils me répondent que non mais que demain à six heures il y en avait un. Moi, aussi malin qu’eux, je voyais bien le piège dont ils me tendaient. C’était pour me faire coucher chez leur associé. « C’est bien je leur dis, je vais y aller voir… Oh, vous perdez votre temps car nous le savons mieux que personne, couchez plutôt ici chez ce monsieur que voici, vous y serez très bien…». Moi je réfléchis un instant et puis je me dis : il vaut autant que je couche ici, il fait encore jour, j’aurai le temps de donner un coup d’œil sur la ville.

Poitiers (Vienne) - La Place d'Armes et le Théatre, Cartepostale vers 1900
Je suivis donc le maître d’hôtel qui me conduit chez lui et là je dépose mon baluchon et puis je bois la goutte ; et quoique fatigué, je sors me promener. Le hasard me conduit dans une promenade plantée en peupliers d’Italie. Cette promenade fait presque tout le tour de la ville et la manière dont elle est vaste, je la regarde comme le point le plus remarquable de la ville. De là, je passe sous une porte antique qui est le reste des fortifications. Plus loin se trouve la gare du chemin de fer. Cette gare quoique vaste est construite en planches et à la droite se trouve un coteau énorme dont je regrette n’avoir pas grimpé pour mieux admirer la ville. Mais ce soir c’était presque impossible car il faisait déjà nuit et pour trouver mon hôtel c’était bien temps de me retirer, même je doutais de ne pouvoir le trouver car je n’avais ni le nom de la rue ni le nom du maître d’hôtel.
Cela ne faisait rien. J’arrive à la place où j’avais rencontré le maître d’hôtel et là je reconnais bientôt mon chemin direct. J’arrive à l’hôtel, je ne trouve personne qu’une petite fille âgée d’environ quatorze ans. La petite me reconnut car quand j’avais déposé mon baluchon, elle se trouvait là. Elle m’invite de m’asseoir d’un air très honnête. Je prends donc une chaise et je mis le feu à mon tabac pour me distraire en attendant l’arrivée de l’hôtesse.
Un instant après, la maîtresse arrive. Elle demanda si je voulais prendre quelque chose. « Mais oui Madame, je veux dîner, avez-vous quelque chose à me donner à manger ?... Non Monsieur, je n’ai rien dans ce moment ici car il fait si chaud que la cuisine ne se garde pas et par conséquent je vais chercher au voyageur ce qu’il me demande…Et bien, allez me chercher quelque chose…». A ces paroles elle part et puis elle revient avec un morceau de fromage de porc qui me fut servi sur la table et en plus un petit fromage blanc.
Page 22
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________Me voila disposé à manger. Je goutte le fromage de porc qui n’était pas tout à fait de mon goût. Je lui demande de quel prix était ce met peu délicat, cinq centimes fut sa réponse « Et bien Madame, vous pouvez le garder car pour moi je ne paye pas aussi cher des mets qui ne sont pas de mon goût… Ah !… J’ai été le chercher pour vous et il est à votre compte… Cela est bien mais il fallait me demander mon goût avant que d’aller chercher…». A ces mots, elle devient furieuse en me répétant que je le paierai. Moi je finis de dîner sans avoir fait beaucoup de mal au fromage de porc et je lui demande combien il était dû. « Compris le fromage et votre couche, vous devez un franc cinquante me dit-elle… Comment un franc cinquante et je n’ai rien mangé, de combien est votre couche ?... Cinquante centimes me dit-elle… Comment ?... Je trouve cela bien trop cher pour m’être aussi mal restauré, d’autant plus que je paie presque mon coucher un franc…». A ces mots, l’hôtesse se monte de nouveau et il fallait en finir, je tire deux francs de ma poche en lui disant « Voila, payez-vous, mais surtout je veux avoir des draps blancs…». Elle prit le drap et je monte avec elle et pendant qu’elle remuait le matelas moi je passais l’inspection du drap sur lequel je vois qu’il n’était pas des plus blancs. Je lui dis « Votre drap a servi, il me faut le changer car je paye assez cher pour coucher dans du linge blanc… ». La voila qui roule les yeux en me disant que je voulais commettre et que je ne connaissais rien. « Je vais chercher la police me dit-elle pour vérifier les draps et si mon mari était là il vous ferait descendre les escaliers quatre à quatre… Votre mari est vous ne me font pas peur et la police je ne la crains pas. Je suis un honnête homme et vous êtes une méchante femme !... Tout cela ne m’éprouve pas… C’est ici ma chambre et je veux y coucher… faites mon lit et retirez vous !... ». Mon lit fut fait. Je me couche. Je fus plus de deux heures avant de trouver le sommeil tant la colère me dévorait de me venger contre l’hôtesse qui m’avait si mal parlé.
Sur les minuits, je fus réveillé par des cris répétés et j’entends tous les locataires de la maison descendre pour courir au secours. Moi je saute du lit ; je prête l’oreille un instant. Là je reconnais que c’était un incendie et il me vient quelque idée d’aller au secours mais la position dans laquelle je me trouvais me défendait de sortir car l’hôtesse aurait bien pu me faire voir le tour. Dans ce cas là je me recouche et cependant je regrette n’avoir pas donné dans un pareil cas montré mon courage.
Le lendemain à cinq heures, je me relève pour prendre le train de six heures. J’étais au troisième, je descends l’escalier et, ne reconnaissant plus l’appartement de mon hôte, je fus tombé chez une pauvre bonne femme qui a mon approche fut effrayée. Je la rassure en disant « Excusez mon entrée chez vous car je suis égaré, je couche au troisième et maintenant je ne reconnais plus l’appartement de mon hôte…». La pauvre mère me mis bientôt dans mon vrai chemin. Je m’adresse au mari de l’hôtesse duquel je croyais voir me faire des reproches sur ce qui s’était passé la veille, mais non il était doux comme un mouton et poli de même. Cela fit que moi-même, je ne lui parlais pas du peu de délicatesse de son épouse.
Je me dirige donc du côté de la gare sans savoir quelle rue prendre, mais enfin je me souviens que le soir de mon arrivée, j’avais été rendre visite à cet établissement. Je me dirige donc du côté prévu. Comme je marche d’un pas rapide, je passe auprès d’une fontaine qui répandait de l’eau bien claire. Envieux, je me souviens que cette belle eau qui servait à laver les rues m’avait plusieurs fois rendu service. Je finis de remplir ma gourde à seule fin de m’être utile dans mon voyage. Etant occupé à cette besogne, un ouvrier qui allait à sa journée me regarde à plusieurs reprises. Je lui adresse la parole en lui demandant où se trouvait la gare. Celui-ci me dit « Suivez-moi, je vous conduis à la porte même…». Je le suivis et une conversation commence sur la profession de l’un et l’autre. Moi je lui appris que j’étais horticulteur. « Ah !… me dit-il, c’est mon premier métier mais aujourd’hui je suis terrassier… Je lui dis : Pourquoi avez-vous abandonné la clé de la nature pour prendre un état aussi inférieur que celui dont vous êtes versé ?... ».
Page 23
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________C’est voyez-vous me dit-il, que je gagne bien plus avec ce dernier qu’avec l’autre. Au moins je peux m’amuser avec mes camarades, et du temps que j’étais jardinier il fallait être économe par force, sans pouvoir voir les amis… Je ne trouve pas mal de chercher son avantage car tous les états sont bons quand celui qui professe sait se conduire en droit et en raison ; mais vous allez avoir une preuve en moi… Je voyage depuis l’âge de seize ans et depuis ce temps là mon salaire a été très minime. Et bien jusqu’à ce jour je ne laisse derrière moi aucune dette, je ne laisse que des gens qui regrettent mon départ. J’ai porté secours à des ouvriers qui gagnaient le double de moi et pourtant je ne reste pas comme un ermite. Le dimanche, je fais mon délassement comme les autres. Mais il existe chez moi un calcul que tous les ouvriers n’ont pas et cependant sans ce calcul la vous gagneriez dix francs par jour, vous ne seriez plus avancé que moi qui gagne que trois francs…». Le pauvre garçon ne su que me répondre… Il me montre la gare et puis nous nous séparons.

Poitiers (Vienne) - La Gare, Carte postale vers 1900
Comme j’étais arrivé avant le départ du train, cette petite halte me donna le temps de réfléchir sur mon arrivée à Tours. J’avais encore dix francs, il m’en fallait six pour me rendre à Tours et à défaut d’ouvrage, comment faire pour aller plus loin ?... Seul, assis sur une pierre, toutes ces chimères me passaient par la tête. Enfin je me souviens de la vie de René Caillé(*) voyageant le désert parmi un peuple sauvage. Ce fameux voyageur, natif de Mauzé, département des Deux-Sèvres, à deux lieues de chez moi, qui pendant trente ans couru et brava tous les dangers de la mort, est venu mourir dans son pays. Ce souvenir me valait dix louis dans ma poche…
Six heures sonnent, je pris le train. Le voyage fait aussi promptement ne me donna pas le temps d’apprécier ces riantes campagnes. Cependant, ma tête à la portière, j’examinais ces vastes prairies que le sol était encore couvert de foin et puis ces jeunes paysannes, le chapeau de paille sur la tête, occupées à étendre l’herbe derrière la faucheuse. Quinze lieues se sont écoulées sans que cette contrée donne de variantes, seulement nous passons un pont qui me parut d’une longueur étonnante. Ce pont est sur la Vienne dont deux arches servent à l’écoulement de l’eau et le reste pour donner le niveau à la ligne du chemin de fer.
(*) René Caillié, explorateur français, 1799 Mauzé sur le Mignon – 1838 Saint Symphorien du Bois (Charente-Maritime)
Page 24
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________Nous arrêtâmes dix minutes à Châtellerault qui se trouve à 60 km de Poitiers. Moi je donne un coup d’œil sur cette petite ville qui me parut d’une hauteur surprenante. On aurait dit que cette ville avait été bâtie en un jour car toutes les maisons paraissaient neuves et toutes couvertes en ardoises. C’est dans cette ville que se fabrique toute cette coutellerie qui se vend aussi bon marché, du reste les voyageurs qui n’ont jamais passé dans cette ville ne peuvent se faire une idée du commerce du commerce des couteaux de Châtellerault, car moi j’ai vu des femmes et enfants offrir à pleines mains les couteaux aux voyageurs à des prix surprenants.
Nous partons de Châtellerault, deux stations plus loin je commence à apercevoir le désastre de l’inondation de la Loire. Je vois le blé resté sur place, les prairies noyées. Ce tableau me donna une idée du désastre de Tours. Je trouvais que le chemin de fer n’allait pas assez vite pour contempler de mes propres yeux ce que les journaux m’avaient instruit. Nous passâmes la ville perdue où je remarque un château qui mérite de faire partie de cet ouvrage. Ce château est du genre chinois, bâti en pavillons. Enfin, ce beau morceau frappa l’œil de tous les voyageurs qui se trouvaient dans la même voiture que moi.
Nous arrivons donc autour de dix heures et demie, j’attrape mon baluchon et je me dirige sur la ville. En sortant de la cour de la gare, un commissionnaire voyait que j’étais voyageur me demande si je voulais aller chez la Mère(*). Je lui réponds d’un ton sévère « La connaissez vous notre mère ?... Je suis horticulteur… Oui me dit-il, suivez-moi… ». Je le suivis, nous ne fûmes pas bien loin il me conduit chez la Mère, Madame Arraud. Moi, sitôt rentré, je demande à mon commissionnaire ce qui lui ferait plaisir de prendre. Celui-ci me répond « Votre goût sera le mien… ».
Je fis venir une bière que je partage avec lui et puis je passe dans la cuisine où était la mère. Je lui demande comment allait l’ouvrage « Très mal dit la mère, l’inondation a démuni nos patrons de tout. Ils n’ont plus rien, ainsi comment voulez-vous qu’ils prennent des ouvriers ?… ». La Mère me dit « Votre commissionnaire vous attend… C’est bien je suis à lui… ». Je fus lui payer la commission, trente centimes était la somme. Il part ensuite. Moi je me promène dans la salle, fumant une pipe.
Un ouvrier attablé avec le Père m’adresse la parole en me demandant si j’étais jardinier « Oui Monsieur, à votre service… Et bien voulez-vous accepter un verre de bière avec nous ?... Avec plaisir mon pays, car je crois que vous êtes jardinier aussi… Oui, je le suis… ». Je pris un verre de bière et je lui demande les adresses des patrons qu’il me donna avec plaisir. Je pars ensuite pour m’assurer de l’ouvrage. Je fus d’abord chez Monsieur Delaire, mais celui-ci me dit d’un air triste « Nous n’avons plus rien, voyez le désastre, je suis obligé de renvoyer mes ouvriers. Je ne peux pas prendre de nouveaux. Aussi, voyez chez les confrères. Allez d’abord chez Monsieur Chatenay… ». Je fus donc chez Monsieur Chatenay, sa réponse fut à peu près la même que celui du premier.
Je ne perds pas courage, je gagne la grille de fer, le boulevard Béranger et là, dans une petite rue à droite, j’aperçois l’enseigne de Monsieur Prout horticulteur. Je fus m’adresser chez lui mais il ne s’y trouvait pas, je trouve seulement sa femme qui me reçut assez mal. Je lui confie le désir que j’avais de travailler chez Monsieur, mais Madame Prout me dit d’aller chez des jardiniers maraîchers plutôt que de m’adresser chez des fleuristes. « Madame je lui dis, si je voyage c’est pour me perfectionner sur l’horticulture et non pas sur la culture maraîchère… ». En lui disant ceci, je lui tourne le dos. Je fus m’adresser dans la rue des acacias et lorsque je fus à quelques pas dans la rue, je rencontre un établissement horticole. Je me présente, demandant de l’ouvrage. On me demande si je savais travailler, si j’avais fait mon apprentissage. Je tire mon livret « Voilà je lui dis, ce qui prouve mon savoir faire et ma conduite… ». Cette dame qui me parlait, ainsi jugea bientôt mes intéressements. « Allez me dit-elle chez mon frère ici à deux pas dans la rue et on vous embauchera…
Page 25
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________(*) Les Cayennes sont les lieux de réunion des compagnons. Ce sont en quelque sorte de grands hôtels, des « auberges » avec chambres, restaurant, et dans la majeure partie des cas bibliothèque, musée, ateliers et salle de cours. Le compagnon y est hébergé durant le temps qu’il lui faut pour atteindre son objectif de perfectionnement. La Cayenne est dirigée par une « Mère », le plus souvent épouse de compagnon, et est soumise à une discipline très stricte, cependant l’on n’y trouve aucune clé ni serrure aux portes ni aux placards afin de ne pas laisser planer le moindre doute quant à l’honnêteté absolue des Compagnons. Un président, ou prévôt, administre la cayenne aux côtés de la mère et procède aux initiations, secondé par le « Rouleur » qui tient les registres. A la fin de son séjour dans chaque cayenne, le compagnon doit présenter une maquette dont la confection réunit toutes les difficultés techniques qu’il veut démonter pouvoir résoudre. C’est le fameux « chef-d’œuvre ».
La France est divisée par chaque corps de métier en un certain nombre de villes du devoir dont la réunion constitue le tour de France.
En 1814, une société du Devoir* divise le tour en quatre parties : l’Orient, l’Occident, le Septentrion et le Midi. Dans chacune de ces parties se trouve une ville de Devoir (aussi appelée ville de boîte). De ces quatre villes principales dépendent toutes celles qui se trouvent sur le Tour de France et les villes qui se trouvent hors du Tour dépendent de la ville de boîte qui est la plus proche. On considère comme ville de boîte toutes celles où se trouvent au moins trois compagnons.
Les principales villes du Tour de France variaient selon chaque métier comme nous l’avons vu dans le chapitre « Tour de France ». Ainsi, le cordonnier Toussaint GUILLAUMOU nous explique dans ses Confessions que pour sa profession l’organisation est ainsi : « Le Tour de France se compose de trois catégories de villes : les villes de boîte qu’on a nommées cayennes après la reconnaissance des compagnons cordonniers par divers corps et qui sont : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes et Angoulême, à qui, malgré son peu d’importance, on a conservé ce titre comme ville de fondation. Les villes intermédiaires comme Auxerre, Chalon sur Saône, Valence, Avignon, Nîmes, Toulouse, etc. étaient des villes « bâtardes » ; dans ces villes on pouvait y faire réception tandis que dans beaucoup d’autres, moins importantes pour la société telles que Sens, Dijon, Vienne, Aix, Narbonne, Carcassonne, etc, il n’y avait que des chambres d’aspirants. Dans celles-ci on ne faisait pas de réception, la caisse était commune, ainsi que le service entre les compagnons et les aspirants qui, à tour de rôle, pouvaient être en premier, deuxième, troisième en ville, ainsi que rouleur. Cependant, presque généralement, la place de premier était occupée par un compagnon qui se trouvait alors être président de la Société ; tandis que dans les villes de boîtes et dans les villes bâtardes la caisse était secrète ; les compagnons seuls disposaient des fonds et seuls aussi ils faisaient le service. »Perdiguier quant à lui nous explique que pour les menuisiers du Devoir de Liberté, les principales villes étaient en 1827 Avignon, Marseille, Nîmes, Montpellier, Béziers, Toulouse, Bordeaux, Rochefort, Nantes, Tours, Blois, Chartres, Chalon, Lyon et Valence. Paris n’y figurait pas. On y ajouta plus tard Auxerre et Sens, et Rochefort fut remplacé par La Rochelle. Dans les villes bâtardes des menuisiers de liberté, telles que Toulon, Sète, Saumur, Alès, Uzès, Annonay, Vienne, Paris, on ne faisait pas de réception. Les villes de fondation étaient pour les compagnons cordonniers du Devoir de Liberté Bordeaux et pour les cloutiers Nantes. Dans chacune de ces villes il existe une Mère élue par les compagnons selon des formes traditionnelles. Le mot « mère » peut désigner aussi bien l’auberge compagnonnique que l’hôtesse qui la tient et même un homme si nous avons affaire à un aubergiste.
La maison de la Mère est la véritable loge de la corporation, la « Cayenne », le lieu où la société mange et s’assemble et qui renferme les archives et les codes sacrés. Les papiers et registres sont conservés dans chaque Cayenne ainsi que la bourse commune qui sert aux besoins collectifs tels l’assistance aux malades, le soutien aux compagnons qui seraient inquiétés par la justice ou emprisonnés, les enterrements. A cause de la clandestinité, ces documents sont, d’après la légende, brûlés chaque année et l’on mélange leurs cendres à du vin qui est ensuite bu par les compagnons lors d’une assemblée solennelle.
La Mère, qui est le plus souvent une aubergiste, est toujours une femme mariée, d’une probité et d’une régularité de mœurs reconnues. Elle est à la fois maîtresse de maison, lingère, aubergiste et infirmière et est entourée du plus grand respect. Même si le local compagnonnique est tenu par un homme, les compagnons quand ils s’y rendent disent : Nous allons chez la Mère. Le nom de mère rappelle non seulement la maîtresse de la maison, mais la maison elle-même. Les obligations de la Mère sont réglées par un contrat en bonne forme ; sa réception est l’occasion d’une fête solennelle ; une place d’honneur lui est réservée dans toutes les cérémonies et les compagnons ont en général pour elle l’affection qu’ils auraient pour leurs parents ; de son côté, la Mère aime les compagnons comme s’ils étaient ses propres enfants ; elle est fière des attributs et des rubans qu’elle porte et heureuse de son titre. Le mari de la Mère est le père des compagnons, ses enfants sont leurs frères et leurs sœurs.
Lorsque les différents corps d’état d’un même devoir sont peu nombreux dans une ville, ils y ont une Mère commune. Les localités qui ne renferment pas assez de compagnons pour entretenir une mère se nomment « villes bâtardes ». Lorsqu’ils ne sont encore pas assez nombreux pour former une clientèle suffisante à l’établissement, ils demandent qu’au moins une salle ou un endroit leur soit spécialement réservé afin d’y tenir en secret leurs réunion et délibérations.
La mère d’une société profite de sa tendresse envers les compagnons. On ne la change jamais sans avoir levé l’acquit, c’est-à-dire sans lui avoir payé intégralement tout ce que devaient ses habitués, les honnêtes ouvriers comme les brûleurs. « En entrant chez la mère, écrit un ouvrier réformateur, la société a soin de limiter le maximum pour un compagnon et pour un aspirant afin que le chiffre du crédit ne s’élève pas trop haut. Mais cette clause est à peu près illusoire : la mère fait à tous ses enfants des crédits presque illimités car elle est sûre d’être remboursée de ses avances ».
Les villes principales du tour de France ont entre elles, pour chaque métier, un système de correspondance qui permet d’informer tous les compagnons de tout ce qui se passe dans la société. Les expéditeurs qui souhaitent faire circuler des lettres sur le Tour de France doivent en expédier une dans chacune des principales villes du Devoir (villes de boîte) qui elles-mêmes envoient une copie à tous les compagnons dont ils connaissent l’adresse.
Les convocations aux réunions dans une même ville se faisaient de vive voix par un fonctionnaire qui allait d’atelier en atelier ; il n’y avait pas de statuts écrits entre les mains des sociétaires jusqu’à une époque très avancée.
Source : http ://genhames.free.fr/compadmin.htm
Page 26
 ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________Vous ne trouverez pas mon frère car il est parti en voyage, mais vous trouverez mon mari qui le remplace en son absence… Vous lui direz que vous venez de ma part… ». Je remercie cette dame de m’avoir donné une adresse presque sûre et ses paroles morales, ce n’était pas la femme de Prout qui m’envoyait chez les maraîchers proches comme un détenu, non c’est le but très arriéré de prendre de pareil ouvrage et non pas à moi qui ne suis pas sur cette terre pour travailler en esclave. Je dois seulement faire pour la nécessité…
Je fus m’adresser chez Monsieur Porcher, Rue des Acacias numéro 38. Il ne s’y trouve pas comme me l’avait dit sa belle-sœur, mais son frère s’y trouve qui me reçut très honnêtement. Il feuillette mon livret et le trouve bon. Il me demande si je pouvais venir à midi commencer à travailler, car il n’avait pas d’ouvriers dans ce moment et son frère était en voyage. « Les plantes meurent de soif, venez le plus tôt possible et mon frère doit arriver ce soir… Demain, nous nous arrangerons pour le prix… ». Je lui réponds que j’allais retourner chez la mère pour prendre mon baluchon et puis je reviens de suite, et nous nous séparons.
Je fus tout droit chez la Mère qui me demanda si j’avais de l’ouvrage « Oui Madame je lui dis, je commence à midi… Vous avez du bonheur me dit-elle, chez qui allez-vous donc ?... Chez Porcher aîné Madame… Ah !... Vous êtes très bien tombé, je ne croyais pas que vous auriez pu trouver de l’ouvrage car il y a un de vos confrères qui a été obligé de partir à défaut d’ouvrage… C’est bien possible Madame que mes confrères soient partis sans avoir trouvé d’ouvrage, mais c’est qu’ils n’avaient pas bien cherché, car sur la quantité de patrons c’est bien rare si quelqu’un d’entre eux n’a pas besoin après un pareil désastre… Au revoir Madame, je vais commencer à travailler… ».
Voila midi qui sonne, je prends mon baluchon et puis je fus tout droit chez Monsieur Porcher. On me montra ma chambre dans laquelle je déposais mon petit fardeau et puis son frère me montra les arrosoirs et je me mis en besogne.
Il était près de trois heures, personne ne m’offrait rien. Enfin, le frère de monsieur Porcher vient me voir et me demande si j’avais besoin de quelque chose. « Mon Dieu je lui dis, j’aurai besoin de manger un morceau car je n’ai rien pris depuis six heures ce matin… Comment, depuis six heures ?... Il fallait demander à manger. Je vais de suite vous faire préparer à dîner… ». Quelques minutes après, la bonne me fit signe de venir et dans une petite cuisine je fus servi ; et là je reconnais que j’étais bien placé car tout m’était offert avec un cœur ouvert. Après le dîner je reprends mon ouvrage et le reste de la journée fut passé sans trop m’ennuyer.
Le soir étant arrivé, Madame Porcher me demanda si je voulais aller à l’arrivée du bateau de Nantes, que son mari devait arriver avec des paniers de plantes. Moi ne connaissant pas la ville, je paraissais en peine de savoir de quel côté se trouvait le port. La bonne voyant mon égarement dit à Madame Porcher que son mari viendrait avec moi pour me faire voir l’endroit et ensuite pour m’aider à rapporter les paniers de plantes. En effet, le mari de la bonne vient avec moi accompagné d’un autre jeune homme ami de lui. Nous partons tous les trois droit au port et déjà l’heure d’arrivée du bateau était passée, et il n’y avait rien d’arrivé.
Nous nous sommes assis sur un banc de pierre en attendant l’arrivée du bateau. Il y avait déjà une demi-heure que nous attendions lorsqu’un ordre arrive que le bateau était échoué à trois lieues de là et que des voitures étaient parties pour prendre les voyageurs. « Et bien partons je dis aux deux autres et passons en ville car il me faut prendre du tabac… ».
Nous partons ensemble et en passant auprès d’un café je les invite de prendre un verre de bière. Ils acceptent mais froidement, disant qu’ils n’avaient pas d’argent sur eux. « Vous n’avez pas besoin d’argent puisque moi je paie. Si je vous invite, ce n’est pas pour vous battre. Allons, rentrez !... ».
Page 27
 ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________Je fis venir une bière, deux bières, et en buvant un verre de celles-ci, je sus tous les mœurs et habitudes de la maison de Monsieur Porcher ; et du moment, je pensais que cela pouvait être de fable. Mais je sus plus tard que presque tout était vrai.
Nous rentrons chez Monsieur Porcher. On sonne et ce fut lui qui vint ouvrir. Il remercia les autres de la peine qu’ils s’étaient donnée à son égard et moi il me fît rentrer dans son salon. Il me fît l’entrée d’un verre de cognac et il me parla ainsi « C’est donc vous qui êtes à mon service ?...Oui Monsieur, j’ai travaillé ce soir… Ah !... c’est bien… De quel pays êtes vous donc ?... Je suis de Niort, département des Deux-Sèvres et je reprends un second voyage pour la perfection de mon état… Ah bien… demain nous parlerons d’affaires… ». Je fus rejoindre ma chambre, le repos m’attendait. Le lendemain je me mis en besogne. La journée se passa sans que Monsieur Porcher me parle du prix de mon salaire. Ce ne fut que le troisième jour qu’il me demanda quel était le prix que je voulais gagner. « Monsieur, vous savez comme moi qu’il y a des ouvriers à tous prix…Ainsi voyez-moi travailler quelques temps et vous jugerez de mon salaire… ».
Huit jours se sont écoulés, je mis la main à la plume pour envoyer une lettre de consolation à ma jeune sœur et ma belle-mère et ensuite pour faire venir ma malle. Je m’attendais que la réponse serait des reproches, mais non. C’est une lettre sentimentale qui répondait à m’ouvrir le cœur si je l’avais tendre. Les premières lignes, c’est ma belle-mère qui parle et puis ensuite ma sœur.
Epannes le 15 août 1856
Mon très cher fils,
Je réponds à ta lettre qui me marque ton entière réussite en arrivant à Tours. Cher fils, tu dis m’avoir causé de l’ennui en partant. Oui tu ne te trompes pas, mais puisque tu vois ton avantage je ne te blâme pas de le prendre, car je vois que tu a bon cœur et que tu ne m’oublie pas. Seulement je n’aurai pas le plaisir de te voir auprès de moi. C’est une grande privation pour moi car je t’estime beaucoup.
Cher fils, la nuit du samedi au dimanche 9 août, la grêle a fait un dégât considérable dans le pays. La grêle tombait grosse comme des noix, les vignes sont dans un désastre pitoyable. Dans certains endroits, une des nôtres se trouve du nombre.
Au revoir cher fils.
Je t'embrasse, ta mère Ysabet Girard
Cher frère
Tu me dis que les larmes coulent de tes yeux de m’avoir causé autant d’ennui mais il ne serait pas à désirer pour toi que tu prennes autant d’ennui pour moi, car moi mes yeux se pleurent plus d’une fois par jour d’après l’amitié que j’ai pour toi, car je puis dire que jamais je n’aimerai autre personne plus que toi.
Cher frère, ce que je te demanderai, ce serait ton portrait bien imité, je l’embrasserai en place de toi puisque je suis privée de te voir. Tu me dis de ne pas me mettre dans l’esclavage. Oh !... si tu étais auprès de moi, jamais je n’aimerai personne que toi. La mort de notre père m’a mis en deuil et mon deuil deviendrait blanc de te voir auprès de moi ; mais ton départ l’a mis plus noir que de l’encre qui trace ces lignes. Tu me dis de ne pas oublier notre mère, j’ai le cœur trop tendre pour pouvoir l’oublier. Pardonne cette lettre mal dictée car j’ai trop versé de larmes pour pouvoir bien la dicter.
Page 28
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________J’ai expédié ta malle à ton adresse.
Je ne puis pas te donner des nouvelles de notre frère car je ne l’ai pas vu depuis toi, seulement le père Bourdin m’a dit qu’i jouissait d’une parfaite santé.
Au revoir cher frère, je t’embrasse de tout cœur. Je suis ta sœur.
Delphine Gerbier
Oui lecteur, cette lettre aurait fait couler les larmes à tout autre que moi de voir une jeune sœur qui se dévoue toute entière à moi, mais j’ai le cœur comme la pierre. Tout cela fut oublié promptement puisque la faute est faite il faut la suivre. Je respire que pour le voyage et je voyagerai sans que personne ne puisse m’en empêcher. Rien ici bas ne me fait plus envie que de voyager. Pourquoi me faire prisonnier dans un coin du globe pour me le reprocher toute ma vie. Non, je suis libre et je veux voyager, mon travail seul suffira à ma subsistance et ma conduite me servira de passe-partout. Je sèmerai mes traits d’humanité sur mon passage et mes conseils seront donnés à ceux qui me les demanderont pour le bien et jamais pour le mal.
Il y avait presque un mois que j’étais à Tours que je n’avais de camarade que l’ouvrier du frère de mon patron. Le 30 août arrive, c’est la fête des horticulteurs. Je fus invité de partager cette fête avec mes confrères. J’accepte avec plaisir car c’était pour moi une occasion de faire connaissance de mes confrères. Cette fête se fit chez Monsieur Arraud le patron des jardiniers. Nous étions dix neuf et nous passâmes une journée agréable. Mais l’heure de se retirer arrive, il fallut partir. Les plus pressés allèrent se coucher et les autres se disposèrent à passer la nuit blanche. Moi j’étais du nombre, nous restions à dix, nous passâmes la Loire et nous fûmes faire lever un ami à un de ceux qui étaient avec moi.
On frappe à la porte et le jeune homme vient ouvrir. Aussitôt on lui demande de rentrer dans sa maison. Il nous permis de tout cœur, mais son père ne fît pas de même. Il nous fît signe de nous retirer disant que sa maison n’était pas un café pour venir faire bombance ; mais le fils viola la parole de son père, il nous fît rentrer dans sa chambre et la porte fut fermée aussitôt. Par comble de bonheur, il avait un quartaut d’eau de vie au pied de son lit, jugez comme il fallut se priver de boire la goutte. Nous buvions à pleins verres comme de vrais buveurs et nous voilà déjà gris. Nous faisions vacarme, personne ne pouvait dormir, le bonhomme vient nous menacer de partir, mais la porte fermée, il fut obligé de partir sans avoir réussi son dessein.
Ce fut le jour qui nous força à partir. Nous rentrons en ville, chancelant de côté et d’autre et malgré avoir bu toute la nuit, nous avions encore soif. Nous fûmes boire le vin blanc chez un marchand de vin qui se trouvait levé.
Après cela, moi je rentre à l’établissement. Je trouve Monsieur Porcher qui me demande comment s’est passée la nuit. « La nuit s’est bien passée, seulement je n’ai pas beaucoup dormi, mais maintenant je vais chercher le repos car à peine je vois clair. Allez me dit-il, reposez-vous… »
Il y avait deux heures que j’étais couché lorsqu’un confrère qui travaille en face vient me chercher. « Comment me dit-il, on dort les uns sans les autres ici ?... Allons debout, partons chez la Mère, aujourd’hui… » Moi je ne veux pas passer pour un poltron, dans deux temps je fus debout et nous partons de nouveau. Mais cette journée fut plus modérée que la précédente. Ce confrère qui vient me réveiller devint plus tard mon ami intime ; vous verrez plus loin les services que je lui rendis.
Page 29
 ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________Monsieur Porcher, depuis que j’étais à son service, ne m’avais pas encore admis à sa table car je mange depuis un mois seul à la cuisine. Mais un soir il m’avoua son estime envers moi. Voilà comment la chose est venue : Monsieur Porcher avait une pépinière que l’inondation avait totalement ruinée, et dans cette pépinière il se trouvait deux trous qu’une quantité de poissons emportés par les flots était venue s’y retirer. Monsieur Porcher, voyant qu’on lui dérobait ces poissons, se décida d’aller les veiller. Un soir il me prit avec lui et nous partons à la pépinière. Là nous restons un temps déterminé sans rien apercevoir. Nous décidons de revenir sans avoir fait chasse. Nous passons devant un café, Monsieur Porcher voulut payer un verre de vin. Etant dans le café, Monsieur Porcher se trouva avec des amis, c’est ce qui fit qu’il se trouva entraîné à des dépenses plus qu’il ne l’avait pensé. Il demande le compte et au même instant il fouille son porte-monnaie, mais il n’avait pas assez pour payer. Il demande à l’hôtesse de lui faire crédit, mais l’hôtesse d’un air insolant lui dit que le crédit ne lui convenait guère et qu’elle préférait mieux de l’argent à un gage. Moi qui n’avais pas un sou sur moi, je ne pouvais le tirer d’un pareil affront. Monsieur Porcher d’un ton en colère tira sa montre « Voilà Madame, cela peut-il répondre ?… Moi, plus en colère que mon patron je réponds : non, cette montre ne restera pas ici. Monsieur Porcher reprenez votre montre et attendez-moi dix minutes… » Disant cela j’attrape la porte et je cours à ma chambre, je pris trois francs qui me restaient encore et je retourne. Je mis les trois francs dans la main de Monsieur Porcher. Celui-ci paya à l’instant et quelques mots grossiers furent servis à l’égard de l’hôtesse.
Nous sortons donc tous les deux et pour se rendre à la maison, Monsieur Porcher me tint le langage suivant : « Que vous a dit Madame Porcher lorsque vous lui avez demandé les trois francs ?... Madame Porcher n’en sait rien, elle ne m’a pas même vu rentrer, car les trois francs sortent de ma poche… Monsieur, vous savez qu’un péché caché est moitié pardonné et puis Monsieur, je donnerai tout pour conserver votre estime en public… C’est bien Jean, mais bien que Madame Porcher saurait cela, il n’en serait rien car je ne me cache aucunement d’elle. Dans toute autre occasion je lui confierai, mais puisque vous avez su cacher mes défauts, que cela reste chez nous deux… Mon cher Jean, depuis un mois que vous êtes à mon service, vous n’avez pas encore été admis à notre table. Mais vous m’excuserez, c’est là notre habitude de mettre tous les ouvriers qui rentrent manger à la cuisine à seule fin de les connaître ; car vous savez que dans les ouvriers, nous avons des hommes qui ne pèsent pas leurs paroles. Et bien ceux-ci pour l’intérêt de mes enfants restent à la cuisine, mais vous vous mangerez à ma table. J’aurais même dû vous y admettre plutôt car je remarque que vous n’êtes pas un homme moyen et je ne veux pas désormais que vous mangiez à la cuisine… Monsieur, je ne regarde pas comme un mépris de m’avoir mis à la cuisine car j’ignore votre habitude et puis combien même cela ne serait pas, vous pourriez très bien le faire car moi de mon côté je n’ai jamais désiré votre table… Je veux que vous soyez avec moi et dès demain vous mangerez avec moi comme un sujet distingué et vous pourrez être admis à la table d’un seigneur pour votre tenue modeste… »
A dater de ce jour je fus admis à la table de Monsieur Porcher. J’étais très heureux parmi une famille humaine. Monsieur Porcher me regardait comme son fils. Il s’empressait de répondre aux questions que je lui posais de ce qui regarde mon état et comme il était arboriste naturaliste, le soir après le dîner il me donnait des leçons en morale qui rentraient dans ma tête sans beaucoup de peine. Quoique je lui prêchais les conférences, je ne mettais pas moins ses paroles en pratique car je peux bien dire que c’est lui qui m’a tiré le premier du fanatisme dans lequel j’étais plongé jusqu’alors.
L’été se passe.
L’automne arrive, Monsieur Porcher entreprend des jardins neufs pour rétablir les désastres causés par l’inondation de la Loire. Le premier que nous fîmes ce fut à Tours, rue des Acacias, dans une pension tenue par des prêtres appartenant au cardinal de cette ville.
Page 30
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________Monsieur Porcher traças ce jardin avec une facilité étonnante et là je reconnus de nouveau qu’il n’avait pas de rival pour son art. Ce jardin fini, nous fûmes en recommencer un autre dans un petit endroit appelé Amboise à 34 km de Tours où Abdelkader fut captif dans un château de l’Etat.
Portrait de l'Emir Abd-el-Kader (1808-1883) alors qu'il se trouvait emprisonné au château d'Amboise (Archives Municipales d'Amboise)
http://lemirabdelkader.blog4ever.com/blog/lire-article-225984-1036605-premiers_pas_a_amboise.html
Nous étions chez un riche négociant de l’endroit, nous prenions nos repas à sa table et nous couchions à l’hôtel. Rien ne nous manquait trop pour la nourriture et pour le repos. Là je me voyais tenir le rang de la haute classe, répondre à toutes les manies de cette classe. Enfin, nous passâmes deux semaines sans que je fus poussé de m’ennuyer. Monsieur Porcher toujours si bon envers moi, si honnête pour me faire respecter ajoutait le mot de Monsieur à mon nom. Le soir, après la journée, nous allions au café et me demandait mon goût des boissons comme un camarade et jamais c’était à mon tour de payer.
Nous partons d’Amboise, les travaux sont finis. Mais avant de partir, je vais vous donner quelques descriptions de cette petite ville. D’abord, l’inondation du 3 juin 1856 a fait un grand désastre. Des maisons ont disparu au nombre de dix sous les flots du côté de la gare du chemin de fer, et de l’autre côté qui a eu moins de mal, l’eau est montée jusqu’au premier. Rien de plus triste que de voir les habitants ensemble pleurer leurs pertes.
Il y a aussi dans cette ville les restes d’un camp de Jules César qui campa dans la Gaulle, et par dessous ce camp se trouve une cave qui fut creusée pour servir de magasin aux troupes de soldats. Cette cave a 230 mètres de long sur 19 mètres de large. Elle existe encore aujourd’hui. De dessus de ce camp on trouve une petite tour sur le côté gauche de la Loire. Cette tour, bâtie par les anglais, servait de signal par la magie d’une lanterne. Le château de cette ville qui servit de prison au Roi des arabes est un morceau qui n’a peu de rival et couvert de sculptures de l’ancien style. J’ai bien regretté de partir d’Amboise sans faire une visite dans ce morceau gigantesque, mais en voyant l’extérieur je pus apprécier ce que pouvait être l’intérieur.
Ainsi je vais donc m’arrêter ici sur ce qui regarde Amboise.
Je prends le chemin de fer pour Tours, accompagné de mon patron que sa bouche ne cessait de me donner des paroles de consolation et de morale. Ce brave homme, par sa facilité de parler, le rendait agréable en société.

Amboise (Indre-et-Loire) - Vue générale, Carte postale vers 1900 - Editions N.D
Page 31
 _____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ votre commentaire
votre commentaire












